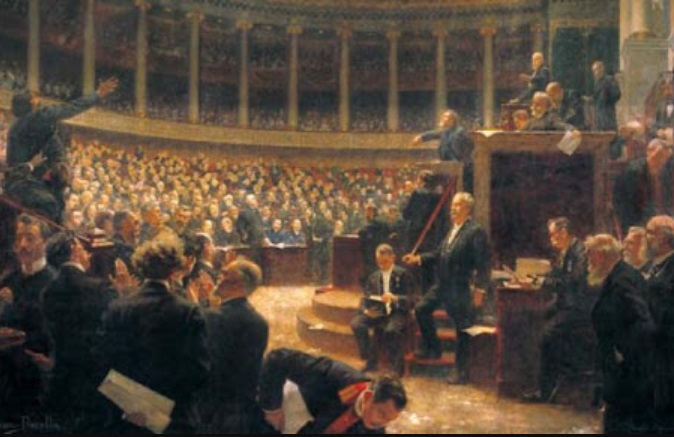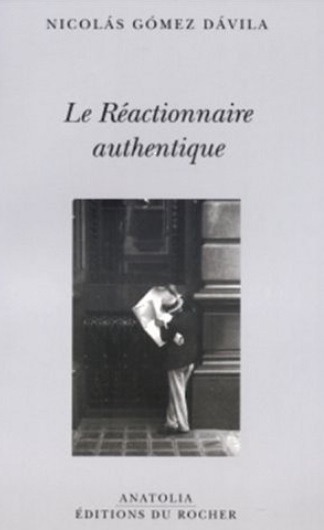Alors que les relations entre décideurs et usagers se tendent et que les conflits sociaux augmentent en nombre et en intensité, les procès en illégitimité fleurissent. Et je voulais évoquer les trois formes de légitimité que l’on peut « légitimement » invoquer.
Il y a certes la légitimité représentative, en politique et pas seulement, qui permet de se prévaloir d’un mandat – plus ou moins impératif. Évidemment, quand on est élu avec un taux record d’abstention qui voisine ou dépasse les 50%, cette légitimité sortie toute propre des urnes est entachée. Et c’est l’un des avantages, et non des moindres, de l’élection des députés par le sort. S’affranchissant du vote, il évite cet écueil.
Continuer la lecture