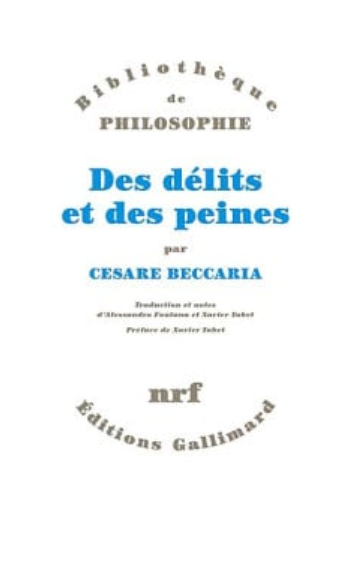La guerre israélo-iranienne semble devoir nous en faire oublier une autre, européenne celle-là. Restons donc au Proche-Orient pour évoquer l’intervention militaire américaine de la nuit dernière : le largage, le 22 de ce mois de juin 2025, de 14 bombes GBU-5722. Et pour remarquer que si Trump, très lourdement, en commentaire de sa décision, a remercié Dieu pour son succès, Netanyahou n’est pas en reste pour évoquer souvent son Dieu et le louer pareillement. Quant au Guide suprême de l’Iran, à qui on pourrait faire remarquer qu’il a suprêmement guidé son pays dans une impasse, toute sa politique est justifiée par la volonté divine telle qu’il la comprend et l’explique. Et ces trois-là étant des monothéistes, ils revendiquent chacun une foi dans le même Dieu. A-t-on affaire à une nouvelle guerre de religion ? Qui aurait pu prévoir que notre modernité serait à ce point religieuse ? Malraux ?
Et cela m’amène à deux remarques, dont la première tient à cette évidente fracture de la civilisation occidentale que J. D. Vance a évoquée dans son discours de Munich de février dernier. Il y a bien aujourd’hui deux occidents. Le premier qui n’a pas rompu avec ses racines religieuses judéo-chrétiennes, et l’autre, Européen qui prend de plus en plus de distance avec ces racines et promeut des politiques plus ou moins laïques. Cette différence étant très remarquable entre la Grande-Bretagne et les USA. Et c’est peut-être moins le continent américain qui a beaucoup évolué sur ce plan, que l’Europe qui a renié ses fondamentaux. Et je remarque que s’il est convenu de nommer l’Europe moderne, et notamment après la création de l’UE, « nouvelle Europe », cette expression était utilisée au XVIIIe et XIXe siècle pour désigner l’Amérique. Comme je remarque que ce sont peut-être les québécois qui se sont le moins éloignés d’un certain parler « vieux français ». Et je crois que dorénavant, à moins que l’Europe change radicalement de chemin, en tournant par exemple le dos au wokisme et en s’affirmant face à l’islam, il faudra bien intégrer cette rupture entre les Occidentaux. Quand, seconde remarque, lors des premiers conflits mondiaux l’Amérique est venue au secours de l’Angleterre (et accessoirement de la France), c’est que ces deux peuples étaient proches et partageaient les mêmes valeurs. Aujourd’hui, Trump l’a assez dit et son vice-président est clair, nous ne partageons plus les mêmes valeurs, et cela modifie considérablement les relations internationales.
Mais je voulais aussi évoquer la question induite de la spiritualité. Car j’entends, ici, certains catholiques engagés, et parfois complaisants avec Trump, saper, tout en prétendant la défendre, la laïcité, au prétexte que la dérive morale de notre nation, et particulièrement d’une certaine jeunesse serait due à une absence de spiritualité, de transcendance, donc de religiosité. Mais cette hypothèse est un peu courte. Faut-il, pour structurer une analyse, toujours opposer spiritualité et matérialisme, alors que d’autres approches sont possibles : laïcité versus religiosité, idéalisme vs consumérisme, ou idéalisme et nihilisme ?
Je pense qu’effectivement nous avons collectivement beaucoup perdu sur le registre des valeurs, de l’engagement, et admettons-le, de la spiritualité. Et admettons aussi que les religions, comme en Iran, répondent à leur façon à ses questions. Mais on peut, bien évidemment, avoir des valeurs – c’est-à-dire penser que tout ne se vaut pas – cultiver une éthique de la responsabilité, être convaincu qu’existent des forces immatérielles, donc spirituelles, que l’on peut créer, invoquer ; et aussi des principes supérieurs à l’homme. Et tout cela, sans passer par la « case » religion. Et je remarque que ces jeunes qui « piquent » des femmes à la seringue le font principalement pour leur interdire l’espace public, dans l’idée de conformer la société à des règles islamiques, donc religieuses, donc spirituelles. Ce qui manque à une certaine jeunesse que l’on qualité dans certains médias de barbare, ce n’est donc pas nécessairement une religion, ce n’est pas la foi en un Dieu quelconque, ce sont des valeurs, des principes moraux, d’éthique… et un idéal, au moins des perspectives d’avenir pouvant constituer soit une utopie collective à laquelle ils pourraient alors travailler, soit une utopie personnelle, singulière, existentielle. Mais ces barbares n’en sont pas là. Et s’il faut réprimer leurs agissements ultras violents, c’est en admettant qu’ils sont le produit de la société que nous avons créée. Soyons plus précis, certains d’entre nous ont fait ce choix politique, et la grande majorité l’a accepté. Nous avons tout cédé à l’économie, et avons accepté que l’intérêt économique le plus trivial devienne le seul moteur du progrès ; alors que cela aurait dû être le désir d’améliorer le sort des gens. Car c’est bien la politique qui est responsable en ayant accepté de réduire les valeurs aux financières et de se voir encadré par la technobureaucratie.
On reproche aux casseurs de n’avoir aucune valeur, mais quelles sont celles de notre société ? Elle les a négligées, puis piétinées, enfin déconstruites, sans les remplacer : merci à la communication, merci à la publicité, merci aux wokistes et autres idéologues qui jouent avec les concepts, au point que même les mots n’ont plus de sens : homme, femme, féminisme, racisme, fascisme, écologie, etc. Et merci au Marché. Aujourd’hui on en vient à envisager – la question étant posée – d’autoriser, voire de rembourser le changement de sexe de mineurs : « Trouble dans le genre », trouble dans les valeurs, trouble dans la tête des gens ; trouble, donc malaise, donc violence.
Ils n’auraient pas de principes moraux… Mais quand une partie de la classe politique ment, se sert dans la caisse, que la république est devenue une république de juges qui font et défont l’état de droit…
Et pas d’idéal ? Mais notre président était lui-même incapable, au seuil de son mandant de nous proposer une vision, un projet, un idéal national.
Quant aux perspectives d’avenir, « no futur ! » Ces jeunes n’ont pas d’avenir, ils le savent. Et ce n’est pas de leur faute. Quoi ? Il faudrait qu’ils acceptent de traverser la rue pour trouver un job… un job de livreur de pizza ? Sans même un statut de salarié ? Et les plus chanceux pourront terminer comme manutentionnaires ou caissières de supermarché. Je comprends qu’ils aient la rage. Je comprends, sans l’accepter, qu’ils s’en prennent aux représentants de l’État qui pourtant n’ont aucune responsabilité dans cette faillite politique. Les seuls vrais responsables ce sont les politiques qui seuls, ont le pouvoir de faire, et puis sans doute les médias, spécialistes du « brainwashing ».
Je conclus en prenant le risque de perdre mon lecteur, car je veux reprendre un fil que j’ai un peu laissé filer, porté et tendu par le souffle de mon humeur du jour. Je reste un esprit laïque, antireligieux, et capable, non seulement de cultiver une spiritualité authentique, mais de croire aussi à la possibilité d’une forme de métaphysique non religieuse, donc à usage laïque ; est-ce possible et qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? A savoir qu’on peut croire – et savoir que l’on croit n’est pas croire que l’on sait – que l’existence de l’humain est tout sauf un hasard, mais plutôt une nécessité, et que donc toute éthique doit être fondée sur un principe de responsabilité et sur le respect et la préservation de ce qui constitue l’essence de l’homme : un être vivant, mais mortel, sexué, en relation vitale avec son environnement naturel, capable d’une vie spirituelle plus ou moins riche, et dont l’intelligence singulière l’oblige. D’où ce principe de responsabilité, bien développé par Hans Jonas.
Revenons une dernière fois à ces barbares. Ils n’ont à l’évidence pas intégré ce principe de responsabilité. La faute à qui ? À leurs parents, sans doute dépassés ? À l’État, objectivement dépassé ? L’État fait tout pour déresponsabiliser l’individu et freiner toute tentative d’engagement collectif. Deux exemples qui m’ont particulièrement frappé : la façon dont un très jeune enfant fait du tricycle est règlementée (port du casque obligatoire) et échappe donc à la responsabilité de ses parents, jugés incapables d’en juger. Et puis celle-ci, cette façon dont une agence de l’État a normé la fréquence à laquelle on doit changer de caleçon.
On ne peut tout à la fois en appeler au principe de responsabilité et infantiliser ces mêmes personnes. Et je pense, très paradoxalement, que ces deux « détails » qui peuvent paraître « amusants » sont plus critiques que l’élaboration d’une loi de finances.
Quant au refus de voir les citoyens s’engager dans une expérience collective, là encore deux exemples sont symboliques. Jacques Chirac a supprimé le Service national et ce faisant commis une faute colossale. Et puis, son successeur Nicolas Sarkozy a utilisé le congrès pour valider en 2008, dans le dos des Français, le traité européen qu’ils avaient refusé. Ce n’était pas alors une faute, mais un crime contre la démocratie ; un concept qui n’a rien de matériel et est totalement intellectuel, donc spirituel. Comment après cela en appeler à un engagement citoyen des jeunes français ?