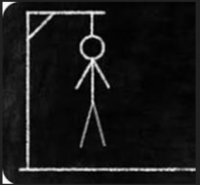Spinoza rappelait « qu’on ne désire pas les choses parce qu’elles sont belles, mais c’est parce qu’on les désire qu’elles sont belles ». Autrement dit, une chose n’est pas nécessairement belle en elle-même, mais possiblement désirée, désirable, aimable, belle à nos yeux amoureux. Et s’il est alors difficile de dire qu’elle est objectivement belle, suivant je ne sais quel canon, alors on déclarera lui trouver du charme.
Prolongeant cette remarque, on doit pouvoir convenir que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes, leur vérité intrinsèque, qui forment la réalité dans laquelle nous vivons, mais le souvenir des expériences que nous en avons faite – ce que l’on nomme notre vécu – et qui a laissé une trace en nous. Cela valant d’ailleurs pour les individus comme pour les sociétés. Chaque expérience laisse ainsi dans notre chair, sous forme d’images imprimées en relief, des empreintes qui sont autant d’ornières affectives plus ou moins marquées dans une matière plus ou moins meuble. Au point que l’on peut dire que notre vécu est une sorte de catalogue d’images indexées. Mais qui ne sont pas comparables à ces photographies de nos livres d’histoire, prises par un appareil mécanique qui reproduit plus ou moins fidèlement les formes et les couleurs. Chaque image gravée dans notre inconscient est en effet indexée, colorée par le climat affectif, émotionnel, dans lequel l’expérience a été vécue : prise de vue, prise de vie, couleurs de l’été ou de l’hiver, pour des émotions allant de l’agréable au pénible, de la jouissance au traumatisme. Nous ne gardons donc pas en souvenir des gens, des lieux, des moments de vie, mais des expériences sensibles et surtout émotives. Et quand ou croit s’en souvenir, on ne comprend pas toujours qu’on en a conservé que la part subjective, émotionnelle. Et si c’est une évidence dont on pourrait se demander pourquoi la rappeler, cela reste une chose dont il faut avoir pleinement conscience. Ainsi si l’on revient sur ces pas, bien des années après une expérience négative, le lieu revisité, quelque soit sa beauté, ne pourra être revu qu’avec un sentiment de malaise, à soi seul compréhensible. À contrario, pour une personne ayant passé des vacances familiales heureuses en un lieu quelconque, ce lieu de villégiature restera pour lui charmant, indépendamment de ses qualités propres. Et cela vaudra pour d’autres expériences passées qui conditionnent fortement notre façon d’aborder de nouvelles expériences mettant le présent en relation avec le passé, ou permettant au passé de resurgir en écho dans le présent. Et si nous vivons tous dans une réalité de perceptions, celles-ci ne sont pas les fruits de processus cognitifs sensitifs et rationnels d’évaluation et, s’il y a jugement, celui-ci, loin d’être le produit d’une rationalité, procède des affects, de la passion. Nous aimons donc ou détestons alors la chose, comme le suggère Spinoza, non pas du fait de ses qualités propres, mais compte tenu des conditions, bonnes ou mauvaises, dans lesquelles nous en avons fait l’expérience. Et s’il convenait de rester avec Spinoza, on pourra rajouter sur le même registre que « S’il n’y a pas de mal en soi, il n’y a que du mauvais pour moi ».
Il est donc difficile d’avoir une perception « objective » des choses, car nous sommes définitivement marqués, formés par notre vécu (expériences, cultures…) et retombons toujours dans les mêmes ornières quand il s’agit d’évaluer le beau, le bien, ou de juger ce que l’on aime et pourquoi on le désir. Ce qui m’a parfois amené à dire que l’individu se réduit à son vécu, son expérience, et peut-être à ses expériences phylogénétiques dont le corps garde la trace. Mais l’esprit et le corps n’est-ce pas la même chose ? Là encore, Spinoza : « L’esprit et le corps sont une seule et même chose, conçue tantôt sous l’attribut de la Pensée, tantôt sous l’attribut de l’Étendue ». Autrement dit, la pensée est la partie immatérielle, et le corps la partie matérielle d’une seule et même chose.
Et il est difficile d’échapper à une façon de voir les choses, si déterminée par des expériences affectives anciennes, si difficile de modifier les images du catalogue de notre vécu, ou de les réindexées, les teindre différemment, d’autant plus que quand on teinte un drap taché, la tache invisibilisée reste présente sous la teinture et réapparait souvent quand la couleur passe au soleil. Et compter sur une possible reconstruction rationnelle de nos souvenirs est une autre illusion, car la raison pèse peu, face à la passion des émotions. Quant à mettre la personne face à ce qui pourrait paraitre comme une erreur, l’écart entre un ressenti qui n‘est pas sans cause et une autre réalité plus objective, c’est alors contreproductif, car cela rajoute de la contrainte, du malaise à un souvenir possiblement déjà problématique. Et on ne peut ni forcer quelqu’un à aimer ce qu’il n’aime pas pour des raisons qui ne tiennent qu’à lui, sans qu’il ressente cette injonction de jouir comme une violence, ni dénigrer ce qu’il apprécie sans qu’il ne ressente une sorte de trahison.
Je traversais cette après-midi une station balnéaire vendéenne que je n’aime pas, pour de mauvaises raisons, je veux dire des raisons personnelles ; et je remarquais une villa que je trouvais avoir beaucoup de charme et où je me serais imaginé, bronzé sur la terrasse, une bière à la main, relisant Spinoza ou Nietzche en attendant l’heure de la baignade en mer. Mais, à bien y repenser, j’ai bien vu que cette villa, assez médiocre par ailleurs, ressemblait beaucoup à celle de mon oncle, où, jeune adolescent, je passais mes vacances à Ronces-les-Bains, avec mes tantes, ma cousine plus âgée. Que de bonheur passé chez cet oncle peu présent, mais que j’aimais beaucoup !