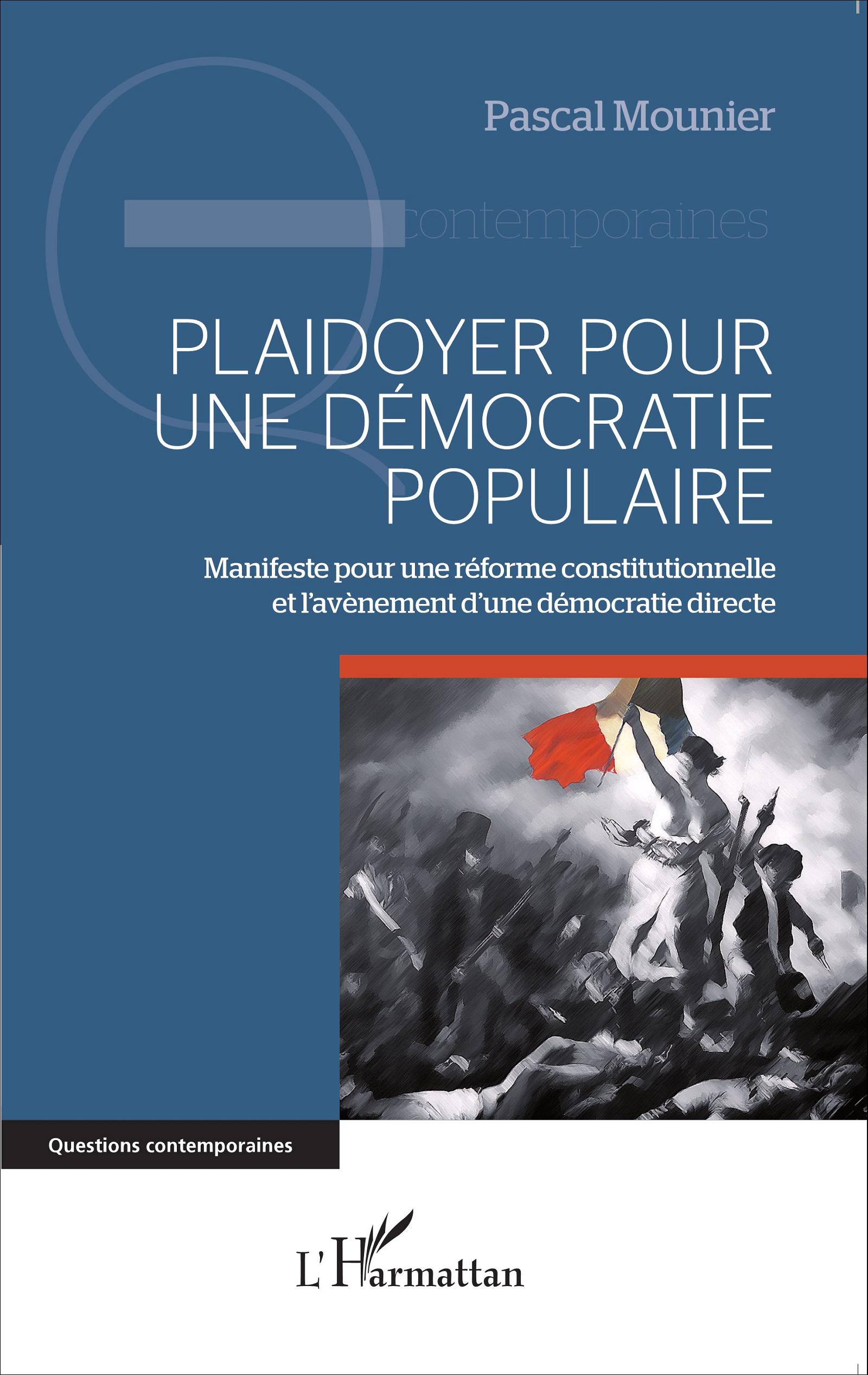Un agité du bocal – comme aurait dit Céline – a tranché la tête de son patron avant d’exposer son macabre trophée sur le grillage de clôture d’une usine iséroise à côté d’un drapeau islamique et d’inscriptions en arabe. Acte politique réfléchi ou crime commis, pour des raisons personnelles, par un déséquilibré sous influence, c’est de toute façon une nouvelle affaire qui intervient dans un contexte instrumentalisé et qui porte la marque de l’islamisme radical.
En janvier dernier, autre affaire sur le même registre, mais beaucoup plus grave, Manuel Valls déclarait qu’il s’agissait, non pas d’une guerre, mais d’un acte de terrorisme, signifiant ainsi aux bienpensants ce qu’ils devaient en penser et en dire. Aujourd’hui, le même parle de guerre de civilisation.
Effectivement, il s’agit bien de cela ; et cette guerre est financée par l’argent du pétrole. L’Occident doit faire face à des idéologies qui portent un nom, le wahhabisme et le salafisme, et qui sont promues par quelques régimes sunnites disposant de ressources financières considérables, au premier rang duquel on peut pointer l’Arabie Saoudite, partenaire et allié des États-Unis d’Amérique et le Qatar, l’ami de la France. Depuis trois ou quatre décennies, les Al Saoud ont investi des sommes considérables (1 à 2 milliards de dollars par an) pour construire partout dans le monde des mosquées et des écoles coraniques[1] et former des prédicateurs radicaux qui appellent au djihad, à la mise à mort des juifs et des chrétiens, et font la promotion d’une justice qui, appliquant scrupuleusement la charia, coupe les mains des voleurs et la tête des mécréants et des apostats. Et ce monstre, qui s’est progressivement émancipé sous la forme d’Al Qaida, puis de Daech, est aujourd’hui incontrôlable, et après avoir combattu les chiites (ennemis des Saoud), se retourne contre les sunnites qui n’acceptent pas l’autorité du nouveau calife.
Mais pourquoi la classe politique occidentale refuse-t-elle de parler de guerre, préférant évoquer le terrorisme ? Parce qu’évoquer une guerre, c’est désigner un ou des ennemis, compter et ses alliés et les alliés d’en face, et que si la réponse adaptée au terrorisme est passive – se défendre –, une guerre exige que l’on soit actif et que l’on mène des actions contre l’ennemi, afin de le détruire. Or, admettre cette guerre, c’est désigner nos ennemis : non pas les musulmans, ni même les sunnites, mais les fondamentalistes et surtout tous ceux qui financent ces idéologies délirantes et mortifères[2], en l’occurrence les régimes saoudiens et qatari. Et l’Occident s’y refuse. La semaine dernière, deux mois après la visite de François Hollande en Arabie Saoudite, notre ministre des affaires étrangères recevait son homologue saoudien. La France, dans le cadre d’un contrat qui pourrait peser une douzaine de milliards de dollars, va lui vendre des armes, des hélicoptères, peut-être des centrales nucléaires. Business is business ! L’argent n’a pas d’odeur. Et l’on voit mal Nicolas Sarkozy, au nom des Républicains, faire un scandale, lui dont le divorce d’avec Cécilia (en 2007) aurait été payé par le Qatar. L’argent n’a pas d’odeur
[1]. Je note dans un article de la Libre Belgique dont je n’ai pas retrouvé les sources qu’en 2007, une étude américaine « révélait que l’Arabie saoudite aurait financé la construction de 1 500 mosquées à travers le monde, 500 collèges islamiques et quelque 2 000 écoles dans des pays non musulmans. Elle aurait également participé au financement des camps d’entraînement paramilitaire et au financement d’achat d’armes ainsi qu’au recrutement de militants du djihad dans une vingtaine de pays ».
[2]. A travers par exemple la Ligue Islamique Mondiale – ONG basée à La Mecque, fondée en Arabie Saoudite en 1962, et qui a pour vocation la promotion à travers le monde d’un islam fondamentaliste –, l’Organisation de la Coopération Islamique – basée à Djeddah et qui promeut la charia, tout en finançant des écoles islamiques –, la banque Islamique de Développement.