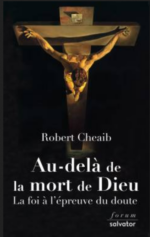Je vais fêter Noël, même si je ne suis pas catholique, pas chrétien pour un sou à la quête… le fêter, oui, bien que j’aie depuis longtemps coupé avec cette religion, en entrant même en militance, un militantisme laïc et antireligieux. Mais ce serait trop bête de perdre une occasion de faire la fête, de se retrouver en famille, entre amis de toutes confessions, autour d’un bon repas. Je sais bien qu’à cette date, on est invité et attendu à la célébration d’un rite millénaire, celui d’une religion qui, en occident, a façonné les manières de penser, longtemps tenu l’enseignement, et politiquement géré des peuples à genoux. D’ailleurs, ni notre principe d’égalité ne serait tel, ni, plus largement, l’humanisme n’existerait sans le christianisme qui les a inventés ou matricés.
On peut donc rester très critique vis-à-vis de tout cela, préférer le sapin enguirlandé à la crèche au poupon, garder ses distances avec l’Église, sourire à sa métaphysique, mais accepter de se retrouver ensemble sur l’évocation d’un symbole. L’Église nous dit que Dieu s’est fait homme un 25 décembre, en Palestine. Certains, dont je ne suis pas, contestent l’idée même de l’existence d’un Jésus prédicateur qui aurait fini, assez banalement, crucifié comme d’autres agitateurs par les Romains. Mais reste un symbole qui s’est construit dans un certain contexte historique, qui a grandi et muri au point d’envahir le monde, et est aujourd’hui contesté. Je suis personnellement attaché à ce symbole, et j’aurais plaisir à lui rendre hommage dans quelques jours. Car laissons de côté l’introuvable vérité de l’évènement historique et métaphysique. Que reste-t-il ? Les allégories de cette parabole qu’on ne cesse d’interpréter. Et pour ce qui me concerne, j’en caresse deux : l’hypothèse improbable qu’il puisse y avoir autre chose, au-delàs de notre sensibilité, quelque chose dont ni notre corps ni notre esprit ne peuvent rendre compte, un au-delà de l’être présent, peccamineux et putrescible. Et puis considérer que la valeur suprême est l’amour, un amour absolu, pur, au-delà de la simple concupiscence, et qui devrait matricer toute éthique, toute hygiène de vie. Ce christ-symbole, s’il l’est de l’espoir et de l’amour, mérite bien qu’on fête sa naissance et qu’on l’honore, quitte à trinquer avec le vin de messe… Mais il y a aussi une troisième dimension de cette parabole qui m’a toujours touché, à savoir que l’être le plus puissant de l’univers, créateur ex nihilo du tout, conjoncturellement incarné pour voir comment ça fait d’avoir soif et faim, puisse être cloué sur deux bouts de bois par un petit fonctionnaire provincial, comme une vulgaire chouette sur la porte d’une grange. L’hyperbole est saisissante, le plus grand se faisant le plus humble.
Autre point qui est venu se lier à cette réflexion. S’il est si compliqué, à propos de la fête de la nativité, de séparer le cultuel du culturel, il est aussi difficile de comprendre, de l’intérieur, ce qui est culturel ou universel. Par exemple de comprendre que l’idée d’humanisme défendue en occident par beaucoup d’athées n’est qu’un autre nom du Christianisme, ou que notre idée d’égalité est ici chrétienne. Reste que deux principes me semblent universels, donc proprement anthropologiques : le bon sens, et le sens de la justice. Chacun comprend plus ou moins clairement, car il en a fait l’expérience, qu’existe une « loi de causalité » que j’exprimerais ainsi : « toute cause produit des effets », ou encore « le réel est ce qui produit des effets ». Chercher la cause qui va produire l’effet désiré, ou constater ce lien, c’est ce qu’on appelle le bon sens. Pour la justice, c’est un peu plus compliqué. Reste que je pense que ce sentiment que telle chose est juste et que telle autre ne l‘est pas n’est pas de dimension culturelle. Mais ces deux principes ne sont-ils pas simplement ceux, originels, et de la morale et de la politique ?