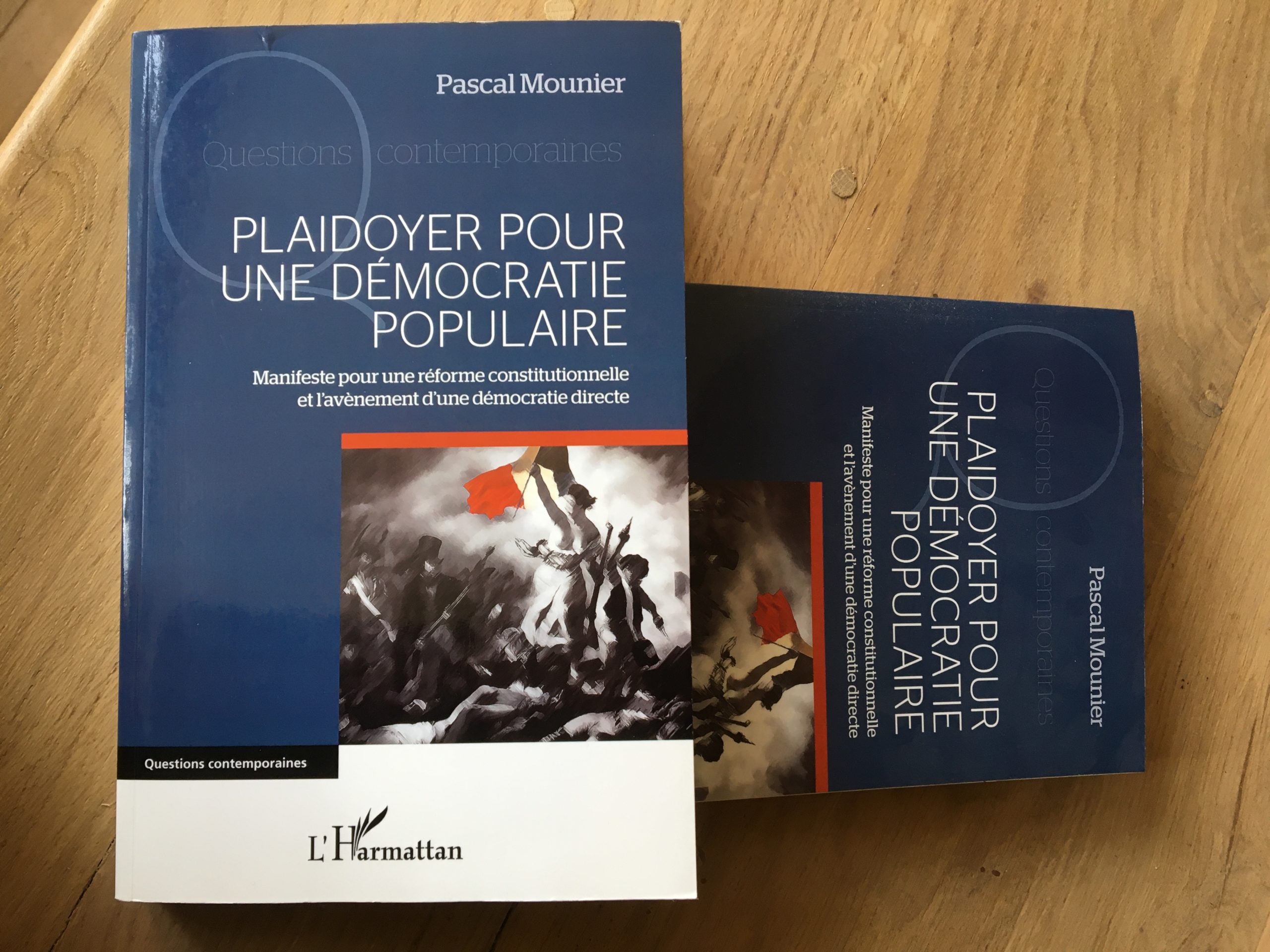Je ne vote plus. Et cela depuis de nombreuses années. Pas par paresse, mais parce que la politique est devenue un spectacle où les électeurs ne sont plus que des figurants. Voyez le drame des paysans : un suicide toutes les 36 heures. Je ne parle pas des agro-industriels qui n’ont que rarement des problèmes de fin de mois, mais des petits exploitants, étouffés par des traités comme le Mercosur, imposés malgré les promesses et les mobilisations. Rien n’y fait. Malgré tous les engagements pris par les politiques, ils vont devoir se laisser enfoncer ce traité dans la gorge, bien profond. Et tant pis s’ils en meurent, étouffés.
Je n’aime pas la politique. Pourtant je reste passionné par la philosophie politique, ouvert aux débats d’idées, très intéressé par la géopolitique. Et si je continue à suivre les campagnes électorales, c’est comme d’autres suivent la Coupe des Nations, ou l’élection de Miss France. Mais je n’aime pas la façon dont elle se pratique aujourd’hui, un mélange de The Voice et de Télé-achat, où les candidats vendent des rêves à des électeurs qui zappent entre les discours bonimenteurs. Les médias transformant chaque élection en compétition people télévisuelle : la Roue de la Fortune, version pouvoir. La fortune, bien sûr, n’est pas pour les infortunés électeurs, mais pour une minorité qui gagne toujours – tandis que la majorité paie, encore et toujours. Car c’est une loi économique simple : dans un processus qui ne produit aucune richesse, il faut que les beaucoup perdent pour que peu gagent. Les affiches et les tracts électoraux finiront donc invariablement comme les promesses imprimées dessus, à la poubelle.
Mais la raison profonde de cette désaffection des urnes, c’est l’éducation. Ou plutôt, son détournement. Nous sommes tous et depuis toujours formatés par notre éducation.
Dans l’antiquité, l’éducation était le fait des familles et de la cité. Elle était sensée produire, ici, de bons Grecs, là de bons Romains, ailleurs des Perses, des Hindous, des Gaulois, etc. Puis, avec la prise du pouvoir par le christianisme, c’est l’Église de Rome qui, en Europe, a fait l’école à nos enfants, avec ce nouvel objectif d’en faire de bons Chrétiens. Après la révolution, avec la séparation de l’Église et de l’État, le Concordat, puis le développement de la laïcité, l’éducation a été transférée à l’État. Et le magistère des maîtres a consisté, non pas à fabriquer des Chrétiens, mais des Citoyens de la République. Autre époque, où l’école républicaine prétendait fabriquer des Citoyens. Elle est close. Dorénavant, c’est le Marché qui forme les gens dans l’idée d’en faire non plus des Citoyens mais des consommateurs, si possible, addicts. Les médias privatisés, l’intelligence artificielle en soutien, et une technocratie méprisante ont remplacé la Marseillaise par des jingles publicitaires. Et, au fronton de nos écoles, notre devise nationale n’est plus qu’une réclame désuète et inopérante. Les « droits » ne sont plus des conquêtes collectives, mais des produits marketing à consommer : un droit à l’avortement constitutionnalisé, un mariage pour tous… Des acquis vendus comme des promotions, à grand renfort de pub, pour masquer l’incapacité du politique à améliorer la vie des gens.
Résultat ? Le grand remplacement : celui des citoyens par des consommateurs : de biens, de services, de droits, d’allocations, de modestes privilèges – laisser passer, j’ai une carte « handicapé » ! Une inflation de biens, souvent inutiles, toujours rapidement obsolescents, et dont la fabrication pollue l’environnement, épuise la planète, aliène nos libertés. Tout cela dans un monde réifié ; réifié, car marchand. Avec une seule idéologie « business is business ».
À terme donc, il faudra ranger les urnes de vote, quitte à les recycler pour en faire des urnes funéraires pour recueillir les cendres de la démocratie étouffée par le Marché.
En attendant, on peut toujours regarder ce cirque de loin – non par indifférence, mais par respect pour ce que la politique aurait pu être et pour les engagements militants de nos aînés.