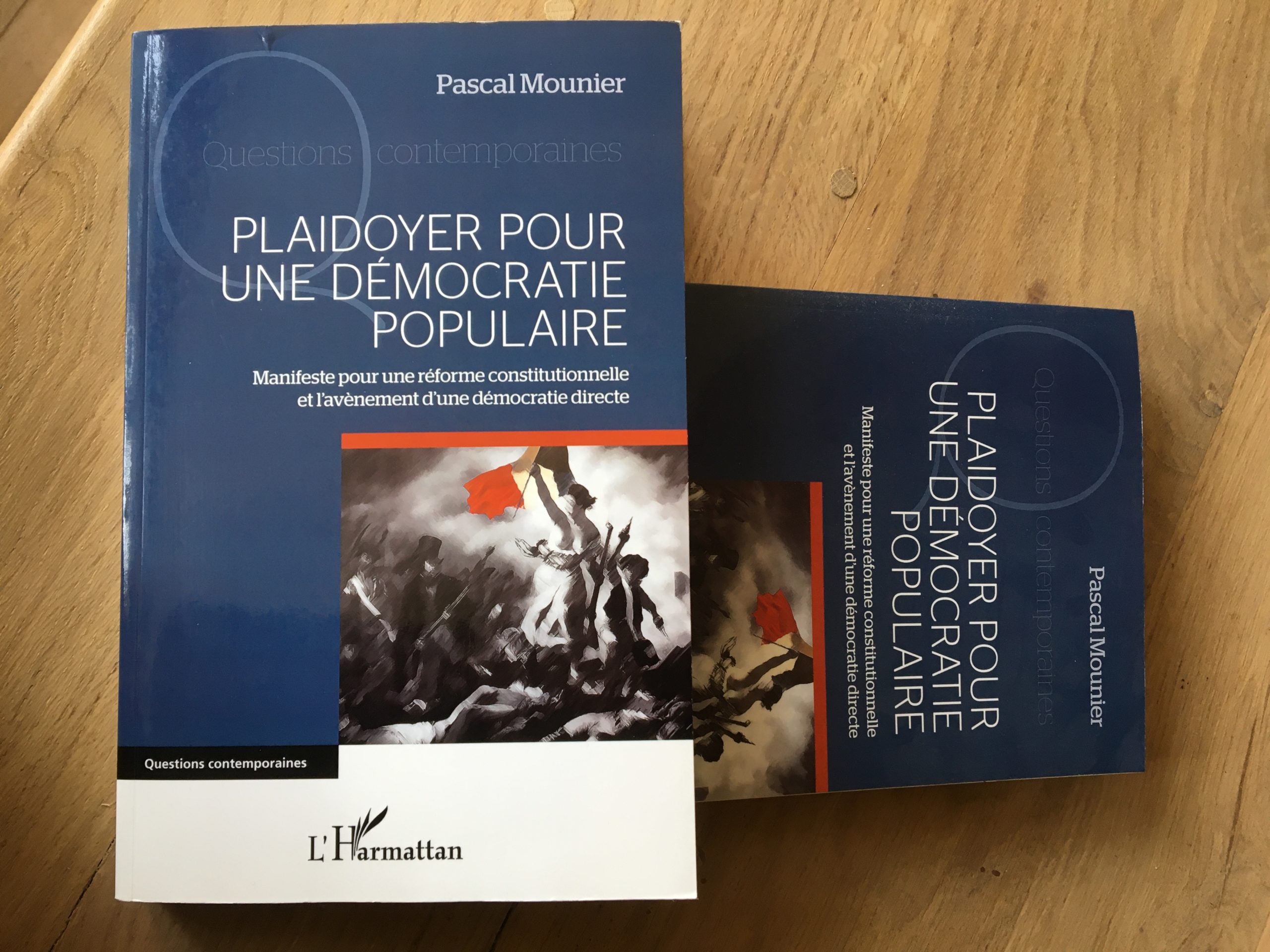Si la pédagogie repose sur l’art de la répétition, encore faut-il, à chaque fois, trouver de nouveaux moyens d’expliquer les mêmes choses. En ces temps de crise institutionnelle où l’on prend progressivement conscience de la fin de la Ve République et de la nécessité d’un changement de régime, il semble utile de revenir aux fondements de la philosophie politique. Et à une comparaison renouvelée de l’aristocratie et de la démocratie, en laissant de côté la monarchie — forme de pouvoir d’un seul, qui, sauf à s’appuyer sur une légitimité divine, risque toujours de dégénérer en tyrannie. Les exemples historiques qui ne manquent pas : Staline, Franco, Castro ou Mao — pour ne citer que ceux qui sont morts dans leur lit — illustrent comment la monarchie, même déguisée, se transforme souvent en théocratie.
L’aristocratie : le gouvernement des meilleurs ?
À entendre certains, notamment européistes et méprisant le populisme – les mêmes qui ne craignent pas d’user de démagogie –, une aristocratie d’experts serait mieux à même de gouverner que des élus du peuple. Leur argument ? La complexité croissante du monde rendrait nécessaire un pouvoir exercé par des spécialistes. Pourtant, cette complexité est largement le fruit de leurs propres actions : ce sont ces mêmes experts qui, en multipliant les normes et les mécanismes, ont créé un système ingérable, dont ils peinent eux-mêmes à maîtriser les conséquences. Leur fuite en avant inquiète : vers quel mur nous entraînent-ils ?
Mais l’aristocratie, si l’on s’en tient à l’étymologie, c’est toute autre chose, c’est le gouvernement des meilleurs (aristoi). Et convenons qu’en bonne logique, « ce gouvernement des meilleurs devrait être le meilleur des gouvernements ».
Mais comment le trouver ? Platon répond précisément à cette question au livre V de sa République. On sait que, pas plus que son maître Socrate ou que son plus célèbre disciple, Aristote, il n’était démocrate. Il défendait au contraire cette idée que « les philosophes doivent être rois ou les rois, philosophes ». Cette formule, souvent mal interprétée, ne signifie pas que les diplômés en philosophie devraient gouverner. Elle souligne plutôt que le pouvoir devrait revenir à ceux qui, par leur quête de la vérité et leur élévation morale, incarnent la sagesse. Ceux-là seuls pouvant être qualifiés de philosophe-φιλοσοφία-philosophía. Socrate, Diogène ou Héraclite — qui n’ont rien écrit — en sont des exemples. Mais comment distinguer un vrai philosophe d’un simple rhéteur ? Platon lui-même en a fait l’expérience : alors qu’il définissait l’homme comme un « bipède sans plumes », Diogène lui jeta un coq déplumé aux pieds, soulignant l’arbitraire de ses définitions.
Pourtant, l’idée d’une aristocratie comme « gouvernement sage du peuple par les plus sages » reste séduisante. Notre prétendue démocratie, en réalité une technoploutocratie, en est loin : la classe politique manque en effet cruellement de vertu et de sagesse. À moins d’accepter le concept paradoxal d’une « aristocratie de la médiocrité ». Et je passerai vite sur ce qu’il convient d’appeler, en utilisant l’oxymore, « démocratie illibérale ». Je pense à ces régimes hybrides, comme ceux observés en Turquie, en Russie ou en Chine qui illustrent comment une élite peut capturer les institutions démocratiques pour servir ses propres intérêts, tout en maintenant une façade électorale. Où l’on y voit que l’expertise peut devenir un outil de concentration du pouvoir, loin de l’idéal platonicien d’un gouvernement des sages. C’est d’ailleurs l’écueil dans lequel la construction de l’EU s’est encastrée.
La démocratie : le gouvernement du bon sens
Si la démocratie se définit comme le « gouvernement du peuple, par le peuple », le parlementarisme en est une version très édulcorée. Les députés, élus par délégation, n’ont pas de mandat impératif ; les partis politiques, qui contrôlent les investitures, gouvernent selon leurs intérêts. L’agora citoyenne étant trop vaste pour être réunie, la représentation est nécessaire. Mais comment garantir que les élus incarnent la volonté populaire ?
Une solution consisterait à redéfinir la démocratie non comme le pouvoir des experts ou des sages, mais comme celui du bon sens. Les citoyens, s’ils ne sont pas tous des philosophes, possèdent une expérience concrète de la vie commune. Plutôt que de chercher des sages introuvables, on pourrait leur reconnaître deux qualités : le bon sens et la connaissance des réalités qu’ils partagent. D’où cette nouvelle proposition de définition : si la monarchie est théocratique ou dictatoriale, et l’aristocratie le gouvernement des sages, la démocratie doit être celle du bon sens.
La crise des institutions appelle à repenser les fondements du pouvoir. Entre l’illusion d’une aristocratie des experts et les limites d’une démocratie représentative captive des partis, une autre voie existe : celle d’un gouvernement du bon sens, où le bon sens collectif et une forme de sagesse collective l’emporteraient sur les intérêts particuliers. Une révolution authentique consisterait alors à libérer les députés de la tutelle des partis, et à introduire une dose de bon sens à l’Assemblée — par exemple, en élisant une partie des représentants par tirage au sort. Ce qui permettrait une meilleure diversité sociale que les élections, souvent dominées par des élites politiques ou économiques. Et des citoyens tirés au sort, conscients de leur responsabilité, peuvent s’engager très sérieusement dans des débats, comme le montrent quelques retours d’expérience ici ou là.