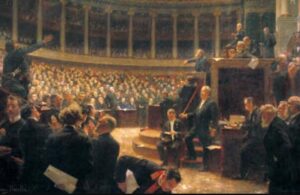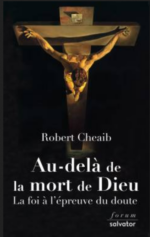Sans nécessairement prolonger mes deux dernières chroniques, qui d’ailleurs n’en faisaient qu’une, je veux évoquer la laïcité, bien que j’en ai souvent parlé ici.
On ne peut réduire la laïcité à un concept contemporain, national, qui serait né au début du XXe siècle, créé par notre Troisième République dans la suite logique de notre Révolution : déchristianisation à compter de 1792 – avec comme point d’orgue, en 1793, la Fête de la Raison à Notre-Dame –, mais restauration religieuse avec le concordat de 1802 – la grand-messe à Notre-Dame à laquelle assista le Premier Consul le 18 avril –, un siècle plus tard la loi de décembre 1905 garantissant la liberté de culte et confirmant la séparation de l’État et des églises chrétiennes et juives… Cette séparation, comprise le plus largement possible, comme un divorce, ayant été refusée par principe par l’Église. Mais ce mouvement de séparation des ordres religieux et laïc était plus ancien, et a constitué le cadre de notre modernité. À son terme – mais n’est-ce pas présomptueux de parler de terme pour un mouvement qui n’a pas été au bout de sa logique, notamment en séparant le culturel et le cultuel –, ce sont deux visions du monde qui se trouvent séparées. L’une, plus ancienne, était celle des monarchies de droit divin, et est restée celle défendue par les religions (y compris de certaines religions prétendument laïques : nazisme, stalinisme, maoïsme… et d’une certaine manière l’humanisme…). L’autre est devenue la vision officielle de l’État républicain moderne. Mais ces deux visions documentées par des livres que je voulais aussi évoquer, restent symboliques, et ont surtout deux sources différentes : pour l’une la révélation prophétique, et pour l’autre, les lumières de l’entendement. D’un côté la foi vécue parfois dans la passion, de l’autre, la froide raison, avec parfois toutes ses dérives déshumanisantes.
En Occident judéo-chrétien, la vision religieuse a été mise en forme programmatique par la création d’un Livre qui devait faire la synthèse de ce que les hommes devaient connaître (et le Coran a fait de même, mais de manière moins inspirée, sans poésie) : création du monde et de l’homme (métaphysique, anthropologie, téléologie), histoire, morale, éthique et hygiène de vie. Ce texte (La Thora), écrit principalement en Hébreu, a connu successivement une adaptation grecque (la Septante), puis une traduction en latin (la Vulgate), avant d’en connaitre bien d’autres dans toutes les langues de Babel. La Bible a longtemps été le seul livre vraiment édité et diffusé en Occident, avec ses commentaires, au point d’inventer le concept de bibliothèque. Et s’il y eut un Ancien et un Nouveau Testament, la patristique, puis la scolastique, ont produit beaucoup d’autres discours sur le monde, ses origines, sa finalité.
La vision laïque s’est aussi développée à partir de plusieurs textes qui ont heurté frontalement les religieux. Galilée, en 1632, avec son « Dialogue sur les deux principaux systèmes du monde », attaque le premier la métaphysique biblique, en donnant raison à l’héliocentrisme de Copernic contre le géocentrisme d’Aristote. Il sera d’ailleurs, très logiquement, arrêté par l’Inquisition, emprisonné, jugé pour hérésie et devra renier ses conclusions pour ne pas être brûlé vif. Cinq ans plus tard, Descartes publiera son « Discours de la méthode » qui, sans renier sa foi en Dieu, opposera les enseignements religieux au « bon sens », à ce qu’il nomme par ailleurs « la raison ». On peut aussi citer, toujours à la même époque, « Le Léviathan » de Hobbes, publié en 1651, et d’autres ouvrages majeurs, jusqu’à « la Philosophie zoologique » de Jean-Baptiste de Lamarck, bien plus tard, en 1809. Ce texte clôturera ces deux siècles (XVIIe et XVIIIe) des Lumières. C’est le premier biologiste, revendiqué comme tel, qui inspirera notamment Darwin et qui oppose à la métaphysique religieuse des théories naturalistes de l’évolution (ou physicalistes).
Et on notera que si ces scientifiques remettent tous profondément en cause la vision religieuse retranscrite dans la bible, aucun n’abjure sa foi ou se déclare athée – tout au plus, pourront-ils être considérés comme déistes, ou panthéiste. Lamarck considérant par exemple Dieu comme « auteur sublime de la nature ». Et Rousseau, comme Voltaire qui utilise l’analogie horlogère, ne dira pas autre chose.
Mais, ce sur quoi je voulais insister, c’est sur deux points qui apparaissent particulièrement dans le Léviathan, livre très long, qui puise abondamment dans le texte testamentaire et dont le titre renvoie directement au « Livre de Job ». Aucun de ses textes ne conteste l’existence de Dieu et ne peut être considéré comme un essai théologique. Mais, de manière implicite, ils plaident tous pour la reconnaissance, dans l’espace public, d’une vérité fragile qui ne procède d’aucune révélation invérifiable, mais d’une démarche rationnelle, scientifique, qui s’appuie sur une méthode apriorique (le doute critique) et une méthodologie qui sera longtemps qualifiée de « géométrique », car, comme la physique a longtemps été réduite à ce que l’on nommait sous l’antiquité « météorologie », c’est-à-dire science des météores, des astres, cette physique constatait que tout était mouvement de corps, et donc transcriptibles en points (un corps étant ce qui occupe, à un certain moment, un espace), et en traits (un mouvement suivant une ligne droite ou courbe, et les astres sur leurs orbites semblant tracer dans le ciel des cercles). Ce pourquoi, Spinoza en publiant son « Éthique » en 1677 – en réalité son ouvrage est publié à sa mort – il le sous-titre « Ordine Geometrico Demonstrata », c’est-à-dire « démontrée suivant l’ordre des géomètres », ou « démontrée suivant la méthode géométrique ». On remarquera encore que si ce texte est écrit en latin, ce philosophe est quasiment le seul, à cette époque, à ne pas rompre avec la langue de l’église de Rome, en choisissant la langue vulgaire de son époque et de son pays : Le Français pour Descartes, l’Anglais pour Hobbes, etc.
Mais je voudrais aussi faire un dernier parallèle entre ces deux approches, religieuse et laïc, et précisément sur l’autorité, celle des religions et celle de l’État. Elles doivent tout, l’une comme l’autre, à une fiction. Pour les religions, l’existence d’un Dieu, tel qu’elles le conçoivent, et d’une supposée relation à l’homme (peuple élu, médiation prophétique, intervention de Dieu dans la vie des hommes, sacralisation, martyrologie). Pour l’État laïc, l’existence du Peuple (bien défini par Rousseau), c’est-à-dire d’une volonté commune suffisamment affirmée pour abandonner sa souveraineté au profit d’une organisation produite par un contrat et constituée civilement. Et l’existence de ce Peuple est d’autant plus symbolique qu’il ne se constitue comme souverain que pour abandonner sa souveraineté. Et, en opposant le parlementarisme et la démocratie, Rousseau le dit assez bien, lui qui pourtant est celui qui justifie le mieux cette fiction : « Le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’élection des membres du Parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien ». Ce qu’il dit là, c’est que le Peuple n’est libre et souverain que le temps d’abandonner sa souveraineté, que pour déléguer ce qui fait son essence. Il n’est Peuple que pour pouvoir cesser de l’être, le temps d’abandonner sa vie, et se trouve miraculeusement ressuscité, pour un temps court, à chaque élection.
En conclusion, mais sans doute aurais-je l’occasion de revenir sur le Léviathan, on ne peut dater la laïcité au 9 décembre 1905, la fonder sur une loi qui ne fonde rien. D’ailleurs, ni le mot laïcité ni le mot laïc n’apparaissent dans ce texte. Et si le mot est bien contemporain, en devenant rapidement un principe républicain de notre troisième république, puis des Quatrième et Cinquième, la chose qu’il qualifie est plus ancienne, à savoir d’une part la distinction entre la foi qui appartient aux consciences individuelles – ce qui est d’ailleurs assez chrétien et peu musulman, considérant que Dieu a une relation singulière et directe avec chaque homme qui souhaite, par la prière, entrer en contact (amoureux) avec lui, et les religions qui sont de l’ordre d’une adhésion collective ou communautaire – et d’autre part le droit civil, du fait que l’État qui doit gérer une société qui peut être multiculturelle, n’adhère ni ne privilégie aucune religion, s’en tenant à l’état de la science tel qu’il peut l’appréhender, et met ses lois républicaines et les impose au-dessus des lois religieuses.
Et cette logique conduit, ce qui n’est pas clairement exprimé pour ménager les uns et les autres, à l’expulsion des religions de l’espace public, et leur relégation dans les sphères privées ou les espaces publics consacrés (églises, temples, mosquées, pagodes, monastères, etc.)