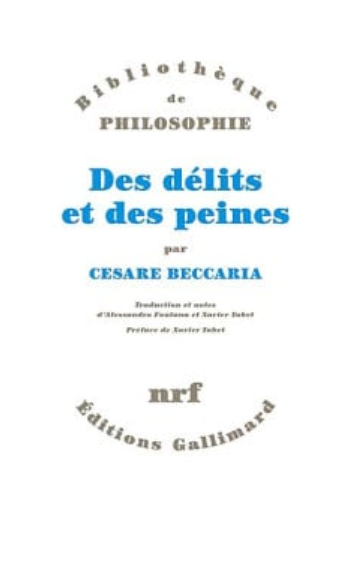Ainsi donc, j’entends un homme politique en mal d’action revendiquer la création d’un nouveau parti politique dénommé : « La France humaniste ». Évidemment, ce nom sent, voire pue la com. La « France humaniste » contre la « France des honnêtes gens » ? Mais on rêverait d’un leader un peu outrancier qui choisirait et assumerait, comme un clin d’œil, « la France des cons ». Coluche aurait pu le faire. Alexandre Jardin, un peu plus fin, et qui a toute ma sympathie – que ne se lance-t-il pas ! –, promeut « La France des gueux ». Personnellement, comme Lang qui se voyait « ministre de l’intelligence » – plus précisément, il avait envisagé de rebaptiser son ministère de la culture, ministère de l’intelligence –, je me verrais bien créer le Parti de la « France intelligente et modeste », pour inviter des millions d’électeurs à s’y reconnaître et à m’y rejoindre, moi le président des gens intelligents et modestes.
Et « humaniste », qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est bien souvent, comme cette idée « d’honnêtes gens », un concept un peu fumeux, du pain béni pour la publicité et pour les opportunistes. Pour moi, c’est l’autre nom du christianisme, un christianisme laïc, culturel, celui de Montaigne par exemple. Mais l’ancien médiocre premier ministre d’un de nos plus mauvais présidents ne va pas si loin. Et personne ne sait vraiment ce qu’il entend par là. D’ailleurs, il n’existe aucune vraie définition de l’humanisme, si ce n’est cette idée contestable de mettre au-dessus de tout l’homme et ses valeurs. Mais encore faudrait-il définir, à l’aube du transhumanisme, au moment où l’IA surpasse l’IN (la naturelle), quand une pseudo théorie du genre conteste la vision d’un humain comme être vivant et mortel sexué, ce qu’on entend par Homme.
L’humanisme n’est pas plus un concept fermé, une idéologie au cadre clair. Ce n’est qu’un sujet de philosophie, comme la liberté si l’on veut. Quant aux valeurs humaines… Convenons tout d’abord qu’il n’y a de valeurs qu’humaines. Mais surtout que la formule n’engage à rien si on ne les défit pas préalablement. On pourrait opposer au moins deux choses à cette tentative de définition. Mettre l’homme au-dessus de tout, c’est aussi le hisser au-dessus de l’animal, tout en haut, dans l’ombre divine ; ce que l’Occident, mais pas seulement, a toujours fait. Et quoi donc de neuf sous le soleil ? Car toute idéologie met ses valeurs (humaines) au-dessus de tout. Le communisme, le fascisme, seraient donc des humanismes. À moins que la bonne définition de l’humanisme soit justement de mettre l’homme au-dessus de ses valeurs, et précisément des collectives. Ce qui reviendrait à considérer que le respect de l’individu dans sa spécificité est la seule valeur qui mériterait d’être sacralisée dans le cadre d’une religion des droits humains, donc d’une vision métaphysique de l’Homme. Sauf que si, d’une certaine manière « Dieu est mort » –, crucifié par le nihilisme, mais je vois bien qu’il remue encore un peu sur sa croix –, l’Homme est, lui aussi, mort, tué par le Marché, étouffé enseveli sous des montagnes de produits de consommation.
Mais remarquons quand même que cet homme politique de plus de soixante-dix ans n’a jamais écrit une ligne, fait un geste, ne s’est engagé nulle part pour défendre l’humanisme tel qu’on peut le concevoir. Alors que nous vivons dans une société très peu humaniste, où la seule valeur qui compte est la fiduciaire, l’argent. Et comme trop de gens de droite, et comme tous les hauts fonctionnaires, M. de Villepin a toujours accepté que le progrès soit essentiellement tiré par la recherche du profit, et il a toujours considéré l’économie de marché comme seul horizon politique. La preuve étant qu’aujourd’hui encore, au moment de son « engagement » pour 2027, il ne s’exprime que sur le financement de la retraite des salariés.
On cite parfois Pétrarque comme le père de l’humanisme, car c’est l’un de ceux qui, à la Renaissance, ont souhaité renouer avec une culture antique que notre Moyen-âge barbare avait perdue de vue, voire mépriser. Est-ce son programme ? Renouer avec un certain passé ? Mais lequel ? Non, il s’agit évidemment de mettre en avant l’humain, ses besoins et ses droits et surtout de respecter tout cela. Ou peut-être plus simplement de mettre un concept au service d’une ambition personnelle. « Aimez-vous les uns les autres ». L’humanisme, l’autre nom du Christianisme, je le disais… Mais comment cela est-il par exemple compatible avec la défense d’un état, l’Iran, dont les textes fondateurs prévoient la destruction d’un autre état, par tous les moyens, et le génocide de sa population ? Comment cela est-il compatible avec une religion dont le mot d’ordre est le djihad, c’est-à-dire le meurtre des apostats et de tous ceux qui refusent de se convertir ?
Mais notre nouveau futur candidat à la présidentielle – un de plus et qui n’apporte rien, et il n’a aucune autre expérience que celle de tout haut fonctionnaire – restera dans une ambiguïté dont on ne sort qu’à son détriment, comme le faisait justement remarquer le Cardinal de Retz. De la com, je vous dis, uniquement de la com, ce qu’on appelle parfois de la publicité et qu’on nommait hier encore de la réclame.
Mais en relisant ce texte, je questionne ma compréhension du concept d’humanisme et j’interroge le net. J’y trouve tout et n’importe quoi… comme quoi ? Et aussi cette formule, assez contestable, qui est tout sauf une définition : « L’humanisme met alors en valeur la pensée, la culture et l’art ». De quelle pensée parle-t-on ? De quelle culture ? De quel art ? De la version occidentale de tout cela, de sa version islamique, orientale ou de tout et de n’importe quoi. J’attends des journalistes qu’ils fassent leur travail de questionnement et interpellent M. Benoît Jimenez. Qu’appelez-vous humanisme ? Qui peut se reconnaître humaniste et donc vous rejoindre comme on revient parmi les siens. Une réponse pourrait être sur le site internet de ce nouveau parti, avec son programme. Mais ce site n’existe pas… faute d’idées à présenter. D’ailleurs, les premières déclarations du fondateur de la France humaniste sont consternantes. Dans une interview au Parisien, il déclare « avoir décidé de créer un mouvement d’idées, de citoyens, ouvert à tous ». Comment cette ouverture aux idées de tous et à toutes les candidatures peut-elle être compatible avec un mouvement humaniste ? Et il dit « souhaiter défendre une ligne de justice sociale et d’ordre républicain ». Alors pourquoi ne rejoint-il pas tous les partis de droite ou d’extrême droite, ou le PS ou le PC ou encore les écologistes qui souhaitent aussi défendre une ligne de justice sociale et d’ordre républicain ; ou du moins l’idée qu’ils s’en font ? Et pourquoi ne rejoint-il pas la France des Gueux, ce qui, pour ce semblant d’aristocrate, aurait de la gueule, afin d’amener dans ce mouvement une dimension humaniste ? Je lis encore, aveu clair, qu’il prône une « politique d’équilibre et de mesure ». Traduisez : centriste, macron compatible ; et bien voir que le patron de ce parti de plus, de trop, sera un maire UDI. L’UDI n’étant qu’un prolongement idéologique de l’UDF, un parti de centre droit, chrétien-démocrate, pro-européen, un parti qui fit un bout de chemin, main dans la main, avec le Modem de François Bayrou. Tout est dit. S’il s’agit d’un mouvement, ce mouvement n’est pas celui créé par un courant d’idées, mais bien par un courant d’air.