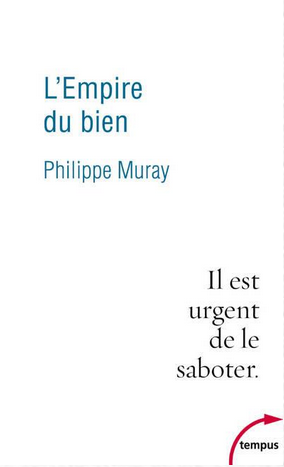Ayant beaucoup et longtemps lu les philosophes de notre antiquité gréco-latine, je suis devenu à la fois épicurien, cynique, stoïcien…, successivement convaincu par les leçons du maître de Samos, ou de Diogène le chien, celui de Sinope, ou encore par celles des philosophes du portique. Ou du moins ai-je été séduit par chacune : ici la recherche du bonheur (et non pas du simple plaisir des sens) par une tempérance et un retour à l’essentiel, là un certain parti-pris du naturel et le refus des conventions morales, là encore une certaine indifférence aux émotions et l’idée de cultiver une âme forte. Car, au-delà de cette invitation à penser que nous offrent tous ces textes, ce sont bien les questions éthiques qui m’ont toujours passionné, et cette idée de quête d’un certain bonheur pouvant seul justifier la triste fin de l’histoire. Et il y a toujours quelque chose à prendre chez nos anciens dont les leçons se complètent, même si je garde une affectation particulière pour les stoïciens : d’abord les fondateurs de cette école, et puis leurs successeurs plus tardifs, dits « impériaux » – notamment Épictète et Marc Aurèle, car ils sont assez « faciles » à lire et forment, compte tenu de leur quasi-contemporanéité (une génération d’écart), un binôme remarquable : l’esclave boiteux grec et son disciple empereur de Rome. Rappelons que la difficulté d’un texte philosophique n’est jamais gage de sa qualité, quand la philosophie doit s’adresser d’abord à l’homme de la rue prêt à faire l’effort de penser, et non à une petite élite universitaire.
Et justement, je veux m’arrêter sur une expression très populaire et souvent entendue quand on fait face à un désagrément inévitable et qu’il conviendrait de « le prendre avec philosophie ». « Soyons philosophe », expression curieuse dans ce contexte où l’on comprend qu’il faudrait se résigner, quitte à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais cette formule réentendue hier et qui me fait régir aujourd’hui – le charme du journal… – est ambiguë et me renvoie bien aux leçons stoïciennes, notamment à cet « amor fati » que Nietzche reprendra, comme d’autres aspects plus métaphysiques du stoïcisme (notamment la palingénésie). Cette proposition éthique « d’aimer son destin » à laquelle j’ai eu tant de mal à adhérer, avant de la comprendre comme une foi en son destin et en l’ordre des choses. Et si j’utilise le terme de foi, c’est pour donner une dimension religieuse qui peut surprendre à ce qui est à la fois de l’ordre de la confiance et de l’amour : confiance en la vie, amour en la vie, amor vitae, amor vitae meae. Et c’est pourquoi, à l’imitation de Spinoza, j’aimerais écrire « Deus sive vitae ». Dieu, c’est-à-dire la vie. Et je l’écris d’autant plus volontiers qu’Épictète, stoïcien tardif, mort en 135 de notre ère, est assez platonicien et déjà préchrétien. Le stoïcisme premier étant clairement matérialiste.
Est-ce bien possible, de manière raisonnable, d’aimer la vie, cette « vallée de larmes », et de faire toujours contre mauvaise fortune bon cœur ? Sauf à noter l’ambiguïté de l’expression qui peut vouloir dire « ne pas se laisser abattre par l’adversité », mais aussi « l’accepter », donc s’en contenter. Ce qui n’est plus du stoïcisme.
Mais il me semble qu’Épictète ne tranche pas complètement une certaine dialectique qui ne pourrait l’être que par la foi. Il en est d’ailleurs toujours ainsi, la dialectique, comprise comme dépassement par le discours des contradictions constitutives d’une réalité, n’est souvent soluble que par la foi, quitte à faire cette pirouette de déclarer, à court d’arguments, « je crois parce que c’est absurde ».
On présente justement la doctrine de l’esclave Épictète comme une invitation à ne pas se laisser prendre par ses émotions, ses peines, ses colères, ses déceptions, ses regrets, mais à se concentrer sur ce qu’on peut faire, ce qui dépend de nous ; et c’est cela qu’il faut bien comprendre, en le reformulant peut-être en terme contemporain : « Cesse de te plaindre et de te laisser guider par tes passions ! et agit pour que ça change ! » – ce qui est, soit dit en passant, l’exact contraire de ce que l’on observe partout, l’opposée de l’attitude commune à laquelle nous sommes tous formés. Et j’aime cette doctrine de l’action tournée vers ce que l’on conçoit comme étant « bien ». J’évoquais une dialectique à résoudre, je la présenterai ainsi : avoir une conscience exacerbée que ce qui se passe – avoir l’esprit de responsabilité – connaître les limites de l’action individuelle ; en d’autres termes, « entreprendre sans espérer ».
Avant de conclure, je rajoute encore un ou deux points – ou des points de suspension à ces mots que je sème ici afin qu’ils germent et puissent développer une pensée. L’amor fati, cet amour de son destin, c’est aussi un apriori eudémonique. Si la recherche du bonheur, de l’eudémonie (du mot grec « eudaimonia » signifiant « béatitude ») est l’objectif de l’existence humaine, alors, pour le stoïcien qui a appris à aimer son sort, le bonheur est déjà acquis. Et c’est en prenant appui sur ce bonheur, ce goût de sa vie et de la vie, qu’il peut agir en trouvant dans ce bonheur les forces nécessaires, et dans l’exercice moral de ses forces, son bonheur. Pour un stoïcien, le bonheur n’est donc pas seulement un but, une finalité, c’est l’alpha et l’oméga de la vie. Et j’aime surtout cette liberté du stoïcien qui n’est pas attaché par l’émotion, lié par des sentiments. Car, pour qu’il n’y ait aucun malentendu, alors que je traitais Épictète, un peu rapidement, de préchrétien, en pensant moins à son éthique qu’à sa métaphysique, insistons sur le fait que le stoïcien est un esprit libre, et qui n’a aucune compassion ni pour lui ni pour les autres, à la limite peut-être de l’asociabilité…