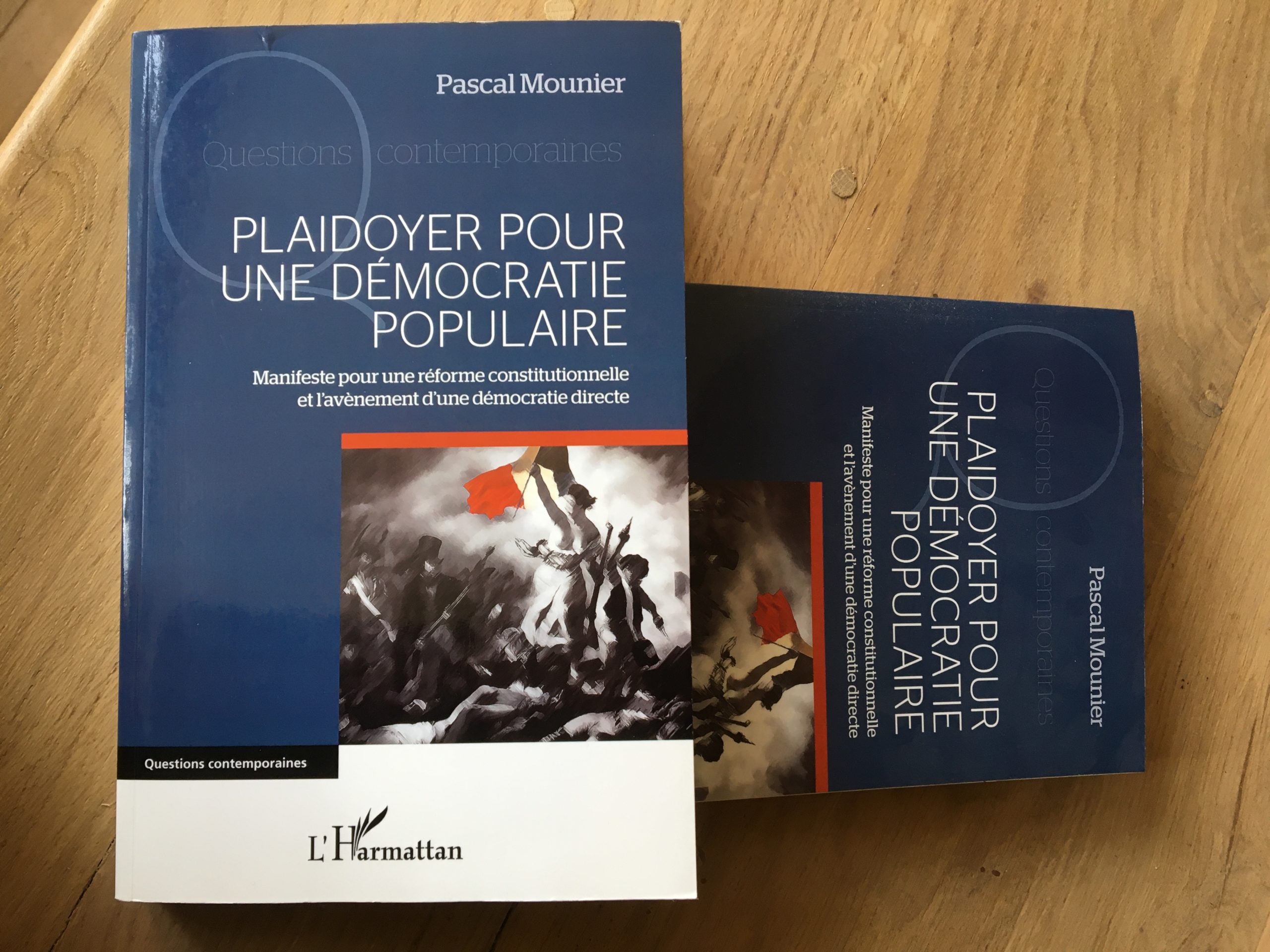Comment définir le progrès, alors que nous constatons que l’avenir qu’on nous prépare est celui d’un regrès nourri de nostalgie ?Les temps d’insouciance sont passés. Le présent est angoissant et la peur est d’autant plus présente que la confiance en l’État a disparu. Regrès, ce concept, antonyme trop peu usité de progrès, devrait être dans toutes les conversations et dans tous les esprits – progrès vs regrès. Le regrès, c’est donc le progrès à l’envers, une élégante descente des marches, sous les feux de la rampe, vers l’enfer totalitaire. Un spectacle où l’on applaudit à sa propre décadence. Et si certains radicaux prétendent « renverser la table », encore faudrait-il qu’il s’agisse d’une « table d’orientation ».
Il y a, dans l’idée de progrès, celle d’avancer et surtout de s’élever. S’agissant des sociétés humaines, ce ne peut être qu’une progression vers le mieux vivre pour tous et une meilleure justice sociale. Peut-on s’accorder sur ce point ? En politique, le progrès est le seul objectif et le seul marqueur qualitatif ; mais un progrès global pour l’homme et la société. Car un progrès strictement technologique peut être un immense regrès pour l’humanité – l’invention de la bombe atomique. Mais ces notions restent complexes quand on comprend qu’un progrès pour l’humanité peut avoir de fatales conséquences pour toutes ces espèces vivantes dont le nombre a tant décru au siècle dernier, pendant que notre démographie sans contrôle mettait tout l’équilibre biologique de la planète en danger. C’est toute la difficulté de discerner ce qui, à terme, sera bon ou mauvais, pour les uns et les autres. Mais, la politique consiste donc à faire des choix, qu’on espère être bons, celui du progrès, de la vie bonne pour chacun et pour tous. Et si je n’évoque pas la philosophie schumpétérienne, c’est que je ne souhaite pas m’égarer en évoquant la « destruction créatrice ».
L’Occident vit une époque de regrès, voire agonique, à l’heure où l’ensemble du monde se recompose. Et je pense – formulation outrancière assumée – que la dérive climatique et celles de la justice française procèdent d’une même dynamique. Et cette déconstruction de notre société favorise aussi un profond nihiliste consumériste, à moins qu’elle ne soit favorisée par lui. Et elle aboutit à une disparition de la foi et à la désacralisation de tout ce qui nous permettait de nous transcender. « Dieu est mort », la République n’est plus sacralisée, la morale devient clanique ou subjective, et notre période est celle de l’abaissement marchant. Dans un monde totalement réifié, la seule valeur qui vaille c’est l’argent. Dis-moi combien tu pèses (de dollars) et je te dirais combien tu vaux. Et Trump en est l’expression caricaturale. Une fois l’édifice culturel déconstruit – l’art étant le substitut naturel de dieu, pour les athées –, il ne restera bientôt plus qu’un tas de pierres. Babel ne sera alors qu’un amas de gravats et nous « déambulerons dans les ruines » – j’emprunte cette formule-titre à un livre de Michel Onfray. Comment s’élever en grimpant sur un tas de pierres qui ressemble plus à un tumulus qu’à un belvédère dressé vers le levant ? La majorité d’entre nous n’a plus d’idéaux, spirituels, éthiques, politiques, car nous ne croyons plus ni en nous ni en nos valeurs, encore moins en l’État. Et pas plus dans le génie créateur de la nature que nous prétendons dépasser, disqualifié. Réifier le monde l’a nivelé. C’est le grand œuvre du Marché et de l’Administration. Nous assistons, impuissants, à une grande déconstruction de notre cadre civilisationnel par une caste de fossoyeurs du passé qui se targuent d’être progressistes. Et si j’avais le talent d’un Zola, je rédigerais un pamphlet pour accuser « ligne à ligne », « thème par thème » cet « état profond » qui s’ingénie – il s’agit bien d’ingénierie – à détruire ce que nos aïeux avaient essayé, avec plus ou moins de bonheur, de construire ; au prix des larmes et du sang. Mais il ne leur suffit pas de déconstruire, ils détruisent, méthodiquement.
On a ainsi partiellement détruit la nation, la famille, la personne, la politique, la démocratie, la justice, nos valeurs de liberté, de solidarité, de responsabilité, de laïcité, etc. À court terme, ne restera que ce qu’il y avait au début, des rapports de force, une majorité d’individus réduits au servage ou à la relégation, par une minorité de possédants qui les contrôleront grâce à des robots boostés à l’IA. Une forme de retour au très haut Moyen-âge, celui qui succéda aux grandes invasions barbares et à la disparition de l’Empire romain d’occident. C’est d’ailleurs le thème de l’excellent livre de Chantal Delsol, La Tragédie migratoire et la chute des Empires. Elle fait très intelligemment ce parallèle entre notre contemporanéité européenne et la réalité d’Augustin d’Hippone, citoyen de Rome, assiégé dans sa ville par les Vandales de Genséric. Mais, plutôt que de la paraphraser, je renvoie à son ouvrage.
Sans avoir pour projet de rédiger une diatribe structurée, que je puisse au moins esquisser le tableau de la destruction systématique de ce monde qui disparaît en évoquant tous ces piliers déconstruits. Et je terminerai cette longue chronique en évoquant l’une des causes de ce phénomène, la plus suicidaire, ce que l’on a nommé, la philosophie déconstructiviste.
En Europe, la politique est morte – marquée par un projet postpolitique, l’Utopie Européenne, une U.E. purement technocratique, sans passion ni humanité, et bientôt possiblement gérée par une I.A. Mais les raisons de cette décadence sont multiples. Retenons au moins la transformation, par le Marché, des gens en consommateurs, et par l’Administration, en assujettis ; le pouvoir de la com et la privatisation des médias ; le désintérêt de la classe politique pour la chose politique et le sort des Français ; la confiscation du pouvoir par la haute administration ; la perte de tout « pouvoir d’agir » des gens dans un monde totalement verrouillé, « totalisant », ou voter ne sert plus à rien. Edgar Morin, dans un ouvrage qui n’a pas vieilli, Où va le monde, tente de distinguer « état totalitaire » et « état totalisant », définissant ce nouveau concept comme un État de plus en plus « Etat–providence et État assistanciel » et qui « étend ses compétences dans tous les domaines des vies individuelles, désormais enserrées dans un réseau polymorphe, à la fois cocon (protecteur, mais éventuellement infantilisant) et nasse ». Le corollaire est que les citoyens sont en voie de disparition comme les visons d’Europe ou certaines familles d’abeilles qui ne sont plus là pour polliniser les champs de la culture. Par contre, la classe politique ne risque pas de disparaître. Ils sont comme des mollusques, collés sur leur rocher constitutionnel, qui défient vents et marées et se concentrent sur des stratégies d’appareils afin d’accéder au pouvoir et à tous ses privilèges. Regrès et regret de cette citoyenneté populaire qui avait progressé tout au long de notre si longue Troisième république – la Révolution française était plutôt censitaire – et qui était au centre du projet gaulliste : progrès, puis regrès, comme un retour du balancier démocratique, exaltation d’un idéal, puis abandon, un abandon que je serais tenté de qualifier de « reprise en main ».
Et nos nations occidentales sont menacées de disparaître, et pas seulement du fait d’une immigration non maîtrisée – je pense au Canada, avant de penser à la Belgique francophone. Thomas Mann, magnifique écrivain, mais conscience politique médiocre, évoquait « le naïf attachement aux intérêts supérieurs de la nation ». Que reste-t-il de l’esprit national ?
Il y a un paradoxe, notamment chez cette « mauvaise gauche » néomarxiste – j’ai forgé ce concept pour dire d’elle tout le mal que j’en pense, tant parfois elle ressemble à une droite radicale. Ce n’est pas la mienne, pas la « bonne gauche ». Et si je peux rajouter une image qui vous fera peut-être vomir, disons que c’est comme une dysphagie, quand on avale de travers, par la mauvaise gorge, et que les aliments font fausse route. Les mêmes qui nous ont expliqué que « le nationalisme c’est la guerre », se portaient hier au secours moral du Cambodge envahi par le Vietnam, et, dans la foulée, refusaient de voir les crimes de Pol Pot. Et les mêmes s’offusquent aujourd’hui du viol de l’intégrité de l’Ukraine en vantant la bravoure de la nation bombardée. Ils condamnent aussi les visées américaines sur le Groenland. Dans le même temps, ils affichent un profond mépris pour la nation française et ne voient pas de problème dans le projet de l’EU de dissoudre notre nation dans autre chose, ou d’ouvrir nos frontières au reste du monde. Le résultat ? Du fait des politiques migratoire et européenne, le pronostic vital de la nation française est sérieusement engagé.
Même la famille est contestée…
Hier, elle était le socle de la transmission et le partenaire naturelle de l’école. Aujourd’hui, elle n’est qu’un « constructivisme social » parmi d’autres, soumis à la norme, et qui doit s’adapter aux dogmes de la sociologie militante. Souvenons-nous que la structure traditionnelle de nos sociétés était familiale et nationale. Et, en Occident, une famille, c’était un couple de parents se partageant l’éducation des enfants et leur transmettant des valeurs nationales. Ce schéma est aujourd’hui très contesté : monoparentalité, homoparentalité, théorie du genre, principes éducatifs délirants refusant toute idée d’autorité. Cela fait beaucoup. Le Mariage pour tous a été une novation intéressante qui a répondu à une demande réelle, mais très faible (moins de 3% des mariages en 2025 selon l’INSEE). Cela peut être considéré comme un progrès, au moins sur le registre des libertés individuelles. Mais, sur le registre de l’éducation, ou du maintien des traditions dans une société bousculée dans son identité, notamment par une nouvelle religion homophobe, on peut se demander si cette mesure « électoraliste » était vraiment si urgente, voire si opportune. Je ne plaide pas pour le conservatisme, ni même pour l’interdiction du contournement des données naturelles – je ne pense pas à l’homosexualité qui est présente dans la nature, mais au fait qu’un enfant puisse avoir comme mère un homme, ou inversement. Mais je crois que des réalités devraient imposer une forme de pragmatisme et de prudence. Nous verrons bien le sort qui sera fait dans quelques décennies aux couples homosexuels quand la France comptera 20 à 25% de musulmans, sachant que les adultes d’alors seront ces jeunes d’aujourd’hui qui, selon un récent sondage, sont 59% à déclarer que la charia doit s’appliquer. Cette loi islamique qui prévoit la mise à mort des homosexuels. On aimerait savoir comment François Hollande voit les choses, lui qui, parallèlement, a largement favorisé l’entrée en France d’immigrés musulmans. Peut-être nous parlerait-il d’éducation de ces jeunes ?
Mais l’éducation et la culture sont, elles aussi, menacées par les médias et les réseaux sociaux. Parlons culture. Nombre de jeunes sont confrontés à un néant culturel et éducatif qui préfère toujours « la performance » – car c’est du consommable dont il ne restera rien, et seul le buzz compte –, à l’œuvre – qui, dans le temps, se confrontera au jugement de l’histoire. Et pour les médias, la culture se réduit souvent à un jeu télévisé.
L’éducation. L’école, fonction régalienne d’un État failli, est dépassée. Elle a perdu toute autorité, face à certains élèves qui contestent l’histoire enseignée, la science officielle, la morale républicaine, l’art classique. D’autres élèves font plus confiance à Wikipédia qu’à leurs professeurs, et seront très vite formés/déformés par une IA dont l’Éducation nationale ne maîtrise ni le code ni les biais. C’est doxa contre doxa, dans une école qui n’est plus le lieu d’apprentissage de références communes – ce qu’on appelait jadis « les humanités » –, mais de confrontations, parfois violentes, pouvant aller jusqu’au meurtre, de communautés qui, faute peut-être de l’avoir compris, ne respectent pas notre laïcité. Et qui considèrent que les hétérodoxes ne sont pas toujours ceux que l’on croit.
En réalité, l’État se désintéresse de l’éducation des individus et laisse faire le Marché qui n’hésite pas, afin de populariser ses messages, à nous abaisser plus que nécessaire. Je remarque d’ailleurs que si l’éducation doit nous faire grandir, le Marché, à rebours, nous infantilise, en promouvant une mode « jeuniste » et puérile. Mais aussi décadente. Et dans ce contexte, j’y reviens, on déconstruit la culture, les arts, les valeurs morales, laissant les jeunes sans formation esthétique : la mairie de Paris préférant ainsi promouvoir Barbara Butch, qui n’a jamais produit aucune œuvre, comme icône médiatique, celle de la décadence, plutôt qu’une « belle personne ». Doit-on nécessairement, quand on est une grande bourgeoise dont les robes coûtent cher aux contribuables parisiens, promouvoir la laideur et le manque de dons (pourvu qu’on se revendique de la famille LGBT+) ? Est-ce pour justifier qu’on est encore jeune, branchée, de gauche ? Je remarque aussi que nos édiles, pour être dans la « bonne » dynamique, celle des courants d’air, enlaidissent nos villes d’aménagements ludiques en les présentant comme des œuvres d’art urbain. Mais cette négation de la culture est aussi le projet stérile de toute une classe politique branchée et progressiste, de droite comme de gauche. Emmanuel Macron ne déclarait-il pas « qu’il n’y a pas de culture française » et Jean-Luc Mélenchon, en référence à notre patrimoine culturel, « il n’y a pas de français de souche », donc pas de réalité française historique. Il faut donc que tout passe à la trappe : la nation, la culture, les valeurs, les individus comme individus.
Pour l’attelage fatal qui nous dirige – ploutocrates et hauts fonctionnaires –, il ne doit pas y avoir d’individus porteurs de singularités, de richesses humaines propres, mais des groupes humains catégorisés, désignés souvent par des acronymes. On peut ainsi limiter la largeur des colonnes des tableurs Excel avec lesquels on rend compte de leur présence au monde sous forme de statistiques. Et l’identité numérique signera bientôt l’arrêt de mort de toute individualité dans une société orwellienne accomplie – on sera bien passé d’une société « totalisante » à une société « totalitaire ».
Venons-en aux valeurs en commençant par la démocratie. Et en rappelant que la démocratie n’est qu’un horizon vers lequel on chemine ou dont on s’éloigne– les Iraniens ont fait leur choix. S’il y a progrès-progression, c’est vers cet horizon. S’il y a regrès-régression, c’est toujours par rapport à cet horizon du désir. Or que voit-on ? Partout l’idée démocratique perd du terrain. Au plan international, et j’y reviendrais, la philosophie de la Déclaration Universelle des Droits Humains de 1948 n’est plus à l’ordre du jour. Cette charte prévoyait implicitement – le cinquième des droits fondamentaux – le droit à la démocratie. Mais ce texte prévoyait aussi le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes, le droit au respect de la vie privée et familiale (aujourd’hui bafoué par le Marché et l’Administration), la liberté d’expression (si questionnée aujourd’hui), la liberté de pensée, de conscience et de religion (niée par les réseaux sociaux). Et si ce texte reste une vague référence en Occident, le reste du monde s’en est complètement affranchi (la Chine, la Russie, La Turquie, l’Iran). La démocratie recule donc partout, et, en Occident, il est de mieux en mieux admis que d’autres civilisations puissent vivre très légitimement suivant d’autres principes. On le dit, mais sans en tirer toutes les conséquences géopolitiques, à savoir l‘abandon du droit international. Quant à la SDN, elle n’a jamais existé autrement que formellement. De même l’ONU, du fait de l’absence d’union des nations. On peut donc comprendre que l’administration américaine souhaite s’affranchir de ce « machin ». Et en Europe ? Le projet de l’UE est objectivement technocratique, profondément antidémocratique. Et l’abandon, en France, de la pratique référendaire, est une preuve supplémentaire de ce regrès.
Reste la justice et le droit. Même sur ce plan, un processus de déconstruction est à l’œuvre. J’ai parlé de la déconstruction du droit international ; il n’existe plus. L’organisation du monde est à nouveau impériale, et, si rien d’extérieur à l’Empire ne peut lui être imposé légalement, son droit propre doit s’appliquer à ses vassaux et états liges. Les États-Unis, qui se sont affranchis de quasiment tous les traités et organisations internationales, ne se gênent pas pour extraterritorialiser leur droit. C’est dans cette optique que la police américaine a pu arrêter le Président Maduro au Venezuela.
En Europe, la chose est plus compliquée encore. Le droit français, de construction latine, est subverti par celui de l’UE, plutôt germanique, parfois anglo-saxon. À terme, il ne sera plus en mesure de gérer notre pays. Et la justice y est devenue politique, tiraillée entre plusieurs idéologies de gauche mal digérées : de la repentance, de l’irresponsabilité, rousseauiste, wokiste.
Nos valeurs ? Elles aussi ont été déconstruites, notamment la laïcité que plus personne ne comprend ni n’applique. Faute d’être actualisées, refondées et ressourcées, elles disparaissent sous les coups de boutoirs des nouvelles religions nationales : l’islamisme, et le wokisme. Et si elles survivent encore, c’est, instrumentalisées à des fins peu vertueuses. Cela dans une société que les plus âgés ne reconnaissent plus. On est passé de l’idéologie libertaire soixante-huitarde – « il est interdit d’interdire » – qui trouvait des vertus à la pédophilie, à une idéologie réactionnaire et puritaine – « le mouvement #MeToo qui ne permet plus à un homme de se trouver seul avec une femme dans un ascenseur. Comme en Islam où une femme non mariée ne peut se retrouver dans une pièce, seule avec un homme. Spectaculaire renvoi du balancier de l’horloge historique.
Nous allons à rebours, régressons chaque jour, moralement, vers l’animalité ; le statut de l’animal de rente dans son usine alimentaire. C’est bien cette question du progrès qui mériterait d’être posée et qui ne l’est pas. Les États-Unis et la Chine, cohérents dans leurs approches impériales, sont en train de matricer le monde de demain. L’islam, quoi qu’on en dise, est en recul, même si la démographie le sauve. L’Europe est sur le déclin, incapable de réagir, et l’Afrique, le grand impensé de notre époque va devoir trouver sa voie. Une époque de renoncement au progrès.