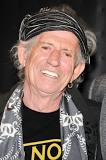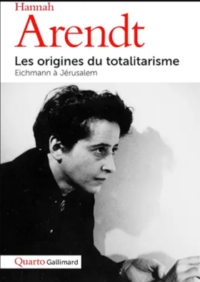On est toujours condamné à se répéter ou à se contredire. Je ne crois pas me contredire beaucoup… mais est-ce vraiment une qualité ? Et à défaut de raffinement, les années qui s’accumulent, comme des boites de conserve vides entassées dans une décharge, forment un lent processus de raffinage de mes angoisses et de mes colères. Non seulement je comprends aujourd’hui mieux ce que je suis, mais je l’accepte comme une fatalité décrétée par un esprit malin, un sacré esprit malin ludique jusqu’à la perversion. Notez que j’avais écrit ici : « putain d’esprit malin », mais vous n’aimez pas les grossièretés, et puis « sacré » renvoie à une dimension divine, celle d’un ange déchu qui s’amuse, lassé des frasques d’une Lilith qui lui est devenu un peu ce que Xanthippe est à Socrate, une chieuse. En fait, il faudrait creuser tout cela, labourer cette matrice à coup de tête ou de rein. Mais ma langue s’égare et je sens qu’à tant de grivoiserie, vous allez vous fâcher. Pourtant, si je me sens prêt à entrer bientôt en enfer, c’est à condition que Lilith en soit la gardienne… Xanthippe, non ! j’ai déjà donné, et cet enfer dure…
Je parlais de raffinage car je peux, à l’infini du temps de ma vie – c’est Woody Allen qui disait que l’éternité c’est long, surtout vers la fin ; pensait-il à Xanthippe ? – commenter ce que je vois, ce que je comprends et pense. Mais je vois trop que j’en reviens toujours au même point, au même niveau de colère et d’angoisse. Et si je suis né comme ça, je mourrai mêmement, que cela vous plaise ou non. Cette modernité de merde, entièrement formatée par l’attelage du Marché et de la Bureaucratie gouvernementale sur un mode consumériste, me gave ; et me révulse tant je pense qu’une autre modernité était possible. Et ses valeurs qui ne sont que des contrevaleurs me font gerber. À vingt ans, je « militais » déjà, un peu naïvement, dans un groupuscule anarchiste. Bien des années plus tard, alors que la logique, le syndrome « Dany le Rouge » devrait être, qu’en prenant des rides, du ventre, et en perdant ses cheveux, on devienne macroniste, je suis en fait devenu ce que j’étais déjà, mais en plus enragé, en plus radical, en plus désespéré. Et j’ai envie de vous crier à tous « je suis toujours un anarchiste et je vous emmerde… » Un anarchiste modèle « Élisée Reclus », libertaire, démocrate tout en étant anti parlementariste, anti religieux sans être nécessairement athée, non-violent mais sans faiblesse – je t’aimerai si je le peux, je te tuerai si je le dois –, féministe en assumant ma virilité (bien qu’aujourd’hui assez fatiguée), naturaliste, écologiste… Un mélange improbable et écartelé entre Proudhon et Tolstoï, Thoreau et Jean-Marie Guyau, Arendt et Ain Rand, Weil et Camus, sans oublier Nietzche, l’antéchrist. Et puis, et puis… individualiste jusqu’au bout du bout, « jusqu’au trognon » pour paraphraser Céline, méprisant les normes, les modes, le politiquement correct, la culture institutionnalisée. Enfin, je suis, bien malgré moi, un mal blanc occidental et capable d’écrire cent essais pour dire tout le mal que je pense de la civilisation judéo-chrétienne. Mais c’est ma famille, c’est comme ça ; et si demain il faut entrer dans une guerre de civilisation, je ferai ce que Reclus fit pour la Commune de Paris, je prendrai les armes pour défendre mes racines, si douteuses soient-elles, et si les forces me manquent, ma hargne de bête fatiguée y palliera.