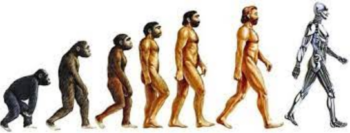C’est notre président qui en a parlé en ces termes, nous apportant de nouvelles preuves de ses talents de communicant. C’est bien un fils de com, pour le meilleur et pour le pire, capable de trouver toujours le mot juste pour marquer les esprits. Sandrine Rousseau, que je cite aussi peu que je l’apprécie, lui a répondu la semaine dernière plusieurs choses dont je reprends deux extraits : « Je vais vous dire et ça va être choquant, mais la baisse de la natalité fait partie des variables qui sont rassurantes » ; et puis encore : « On n’a pas besoin, pour notre système économique, d’avoir plus d’enfants et je le dis en tant qu’économiste ».
À l’évidence, voilà bien un sujet de fond qui mériterait un vrai débat, je veux dire authentiquement démocratique, puis la proposition d’un plan (croissance/décroissance) et une consultation populaire par référendum. Nous n’aurons rien de cela, car nous ne vivons pas en démocratie, mais dans un système de gouvernance où le pouvoir est partagé entre une classe politique qui a perdu de vue ses électeurs, des hauts fonctionnaires faillis, et les tenants du Marché qui ne voient que leurs intérêts.
Et si ce débat nécessaire devait alors lieu, il mettrait en lumière au moins quatre dimensions à la question démographique : géopolitique, économique, environnementale, sociétale. Et j’en néglige ici faute d’inspiration…
D’un point de vue géopolitique, et c’est là où l’on peut parler de réarmement, il faut bien considérer que la démographie est ou a été une arme. On sait que les politiques natalistes menées entre les guerres européennes ou mondiales avaient comme premier objectif de produire des combattants, voire de la chair à canon. Et on comprend que cette question doit travailler le gouvernement israélien. Car on se souvient de la menace lancée par Boumediene, l’ancien président la République Populaire et Démocratique Algérienne, à la Tribune de l’ONU en 1974 : « Avec le ventre de nos femmes nous vaincrons l’Occident ». Plus récemment, Recep Tayyip Erdogan a condamné les idées mêmes de contraception et de planning familial en ces termes : « Nous allons accroître notre descendance. On nous parle de planning familial, de contrôle des naissances. Aucune famille musulmane ne peut avoir une telle approche. Nous suivrons la voie indiquée par Dieu et notre cher prophète ». Faut-il se réarmer démographiquement en vue d’une guerre de civilisation ? Personnellement, je suis pacifiste, car je ne crois pas à la guerre comme solution à un quelconque problème. Mais un pays doit être suffisamment armé pour défendre son intégrité territoriale, ses citoyens et ses valeurs, et surtout l’être de manière dissuasive. Reste à faire les bons choix… Et peut-être vaut-il mieux, en la matière, faire confiance à la mécanique plutôt qu’à l’humain, produire des bombes aussi précises que possible plutôt que de la chair humaine combattante. D’ailleurs ce débat a déjà été tranché en France par Jacques Chirac qui, en préférant en 1997 une armée de métier à une de conscris, a confirmé l’importance « relative » du nombre de combattants. Et la France n’est pas Israël. En conclusion, on ne peut justifier la relance de la natalité dans un objectif de réarmement. C’est pourtant le terme qui a été choisi.
Sur l’aspect économique, qui est le seul qui intéressera toujours notre président, Sandrine Rousseau a raison, d’un certain point de vue… L’économie n’a pas besoin, pour produire, d’hommes et de femmes – ni bientôt pour livrer. Et de toute façon, compte tenu de tous ces fonctionnaires inutiles que l’on pourrait réaffecter à des tâches de production et nos millions de chômeurs – plus de sept millions déclarés à Pole Emploi, mais comme pour les immigrés, nul n’en connait vraiment le nombre –, la question n’est pas là. Même s’il existe objectivement des métiers en tension : chercheurs, médecins spécialistes, urgentistes, électromécaniciens bien formés, professeurs, électriciens automobiles, chefs d’équipe dans le bâtiment, secrétaires connaissant l’orthographe, hôtes ou hôtesses d’accueil dans les administrations – des vrais gens pour régler les problèmes en lieux et places des machines qui le créent –, etc., etc. Et si l’économie a besoin de gens, c’est de consommateurs, quitte à ce que ces consommateurs soient sans emplois, mais allocataires aux revenus suffisants pour faire tourner les supermarchés et absorber la production chinoise. Mais cela au profit de qui ?
Et sur le plan environnemental, tout consommateur est évidemment un pollueur. Il suffit de constater comment la France s’est urbanisée en un demi-siècle et comment nous avons partout détruit, pollué…
Reste la dimension sociétale. Je continue à penser que la promiscuité est un facteur important d’accroissement de la violence. En France, comme partout en Europe et plus largement en Occident, nous sommes trop nombreux. Une décroissance de la population, au moins à court terme, « je vais vous dire et ça va être choquant » ça ne me fait pas peur. Quant à s’attaquer à la perte de la fertilité, c’est un enjeu de santé publique, chaque couple devant pouvoir librement choisir d’avoir des enfants ou pas. Mais reste le problème du grand remplacement qui, dans certains départements, est une réalité mesurable. Je lis dans l’excellente étude de Jérôme Fourquet de « La France d’après » qu’en Seine-Saint-Denis, depuis 2021, plus de la moitié des enfants déclarés portent à la naissance un prénom musulman. À partir de quel seuil sur l’ensemble du territoire (50 %, 75 %, 90 % ?) nos esprits bien-pensants accepteront-ils d’y voir un problème de société ? Mais j’ai peur que ce soit déjà trop tard.
Reste la question, non pas de l’immigration, mais du grave problème de défaut d’assimilation d’une population trop nombreuses à ne pas partager les valeurs occidentales. Nous n’avons ni la vocation ni la possibilité de répondre à la misère du monde, mais seulement le devoir, dans une certaine mesure, de porter assistance à des personnes qui partagent nos valeurs et sont menacées dans leur pays pour des raisons idéologiques. Pour le reste, nous pourrions nous inspirer de certains pays comme le Canada, qui a une politique dynamique d’immigration : sur dossier, une immigration ouverte à des personnes qui maitrisent, à l’écrit comme à l’oral, la langue du pays d’accueil, qui déclarent partager ses valeurs, et qui peuvent justifier de ce qu’ils peuvent apporter : formation diplômante, savoir-faire, projet personnel…
Oui, Sandrine Rousseau…
Mais je rajoute trois lignes, sans vouloir jouer au petit Clausewitz. Si la question du réarmement démographique se pose en ces termes, peut-être vaudrait-il mieux transformer l’OTAN en Alliance Occidentale de Paix, alliance armée, puis rappeler à la Russie que, si elle devait se souvenir un jour de ses racines judéo-chrétiennes, cette Alliance pourrait lui était ouverte. Et puis être prêts à se défendre, sans agressivité inutile.